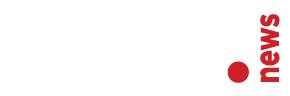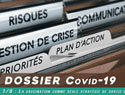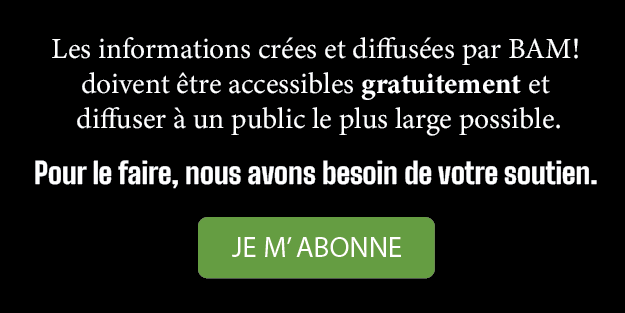Si Netanyahou fustige les pays et organisations qui dénoncent le massacre de Palestiniens en les accusant de complaisance envers le Hamas, l’histoire montre une tout autre réalité. Depuis des décennies, de nombreux faits attestent qu’il a contribué à soutenir et renforcer le mouvement islamiste à Gaza, faisant de celui‑ci un élément central de sa stratégie politique et sécuritaire.
Les origines du Hamas dans les années 1970 et 1980
Le Hamas est issu de Mujama al‑Islamiya, une organisation islamique fondée en 1973 par le cheikh Ahmed Yassine dans la bande de Gaza. Officiellement caritative, cette structure développe des mosquées, des écoles, des cliniques et des bibliothèques. Elle cherche à renforcer la pratique religieuse et à fournir des services sociaux dans un contexte dominé par l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), dirigée par Yasser Arafat et son parti Fatah, qui se veut laïque et nationaliste[1].
En 1979, Mujama al‑Islamiya est reconnue par Israël comme association caritative, ce qui lui permet de collecter des fonds et d’accroître son implantation. Plusieurs responsables israéliens de l’époque admettront plus tard que cette reconnaissance faisait partie d’une logique stratégique : favoriser les islamistes pour affaiblir l’OLP, perçue comme la menace principale[2]..
En 1984, des caches d’armes sont découvertes dans une mosquée liée à Mujama. Ahmed Yassine est arrêté, puis relâché en 1985 après avoir affirmé que ces armes étaient destinées à combattre l’OLP et non Israël. Cette explication est jugée fragile, mais elle convainc les autorités israéliennes qui préfèrent voir croître un acteur islamiste susceptible de diviser la société palestinienne[3].
En 1987, dans le contexte de la première Intifada, Yassine et ses proches fondent le Hamas. En 1988, la charte de l’organisation appelle à la destruction d’Israël et rejette la solution négociée, consacrant l’affrontement total[4]. Malgré ce discours radical, Israël continue à considérer le Fatah comme la menace prioritaire, ce qui permet au Hamas de s’enraciner.
Oslo et la montée en puissance du Hamas dans les années 1990
En 1993 et 1995, les Accords d’Oslo officialisent la reconnaissance mutuelle entre Israël et l’OLP et créent l’Autorité palestinienne. Le Hamas rejette totalement ce processus et lance une série d’attentats suicides visant à saboter le rapprochement. Ces attaques, notamment en 1994 et 1996, frappent profondément l’opinion israélienne[5].
En 1995, le Premier ministre Yitzhak Rabin est assassiné par un extrémiste israélien, ce qui brise la dynamique de paix. Le Hamas apparaît comme un acteur incontournable de la violence, mais son développement reste lié à la tolérance initiale israélienne dans les années 1980.
En 1996, Benjamin Netanyahou est élu Premier ministre en exploitant la peur générée par les attentats du Hamas. Son rival Shimon Peres, pourtant favori, est affaibli par cette vague d’attaques. Netanyahou mène campagne contre Oslo, affirmant que la sécurité d’Israël passe par le refus de concessions. En 2001, une vidéo tournée alors qu’il n’est plus Premier ministre le montre se vantant d’avoir mis fin à Oslo et d’avoir su manipuler Washington, confirmant son intention d’empêcher l’émergence d’un État palestinien.
Retrait de Gaza en 2005
En 2000, l’échec du sommet de Camp David et la visite d’Ariel Sharon sur l’esplanade des Mosquées déclenchent la seconde Intifada. Le Hamas gagne en popularité grâce à son rôle dans l’insurrection, tandis que l’OLP et le Fatah apparaissent affaiblis et incapables de faire progresser la cause nationale. En 2004, Israël assassine Ahmed Yassine, mais l’organisation reste solide.
En 2005, le Premier ministre Ariel Sharon décide du retrait unilatéral de Gaza. L’armée israélienne quitte la bande, mais Israël garde le contrôle des frontières (sauf Rafah côté égyptien, soumis à accords), de l’espace aérien et maritime, ainsi que du registre de population, limitant la souveraineté palestinienne[6].
Cette décision répond à plusieurs impératifs. Sur le plan sécuritaire, l’armée israélienne devait mobiliser en permanence des milliers de soldats pour protéger quelque 8 000 colons installés au cœur d’un territoire peuplé par plus d’un million de Palestiniens, une situation jugée de plus en plus intenable et coûteuse en vies humaines et en ressources. Sur le plan international, Sharon subissait la pression des États‑Unis, l’administration Bush l’encourageant à prendre une initiative visible pour relancer un processus de paix paralysé après la seconde Intifada. Sur le plan politique intérieur, Sharon cherchait à reprendre l’initiative : en opérant un retrait limité et unilatéral, il coupait l’herbe sous le pied à la gauche israélienne tout en consolidant le contrôle d’Israël sur les grands blocs de colonies en Cisjordanie, considérés comme stratégiques. Sharon lui‑même résumera plus tard son objectif en expliquant que le désengagement de Gaza permettait de « geler le processus politique » avec les Palestiniens et d’imposer une nouvelle réalité sur le terrain[7].
Les élections de 2006 et la division palestinienne
En janvier 2006, le Hamas remporte les élections législatives palestiniennes. Le scrutin est jugé libre et transparent par les observateurs, mais il provoque un choc international. Les États‑Unis, l’Union européenne et Israël considèrent inacceptable qu’une organisation classée terroriste gouverne. L’aide internationale est suspendue.
En 2007, les tensions dégénèrent en affrontements. Le Hamas chasse le Fatah de Gaza, qui se replie en Cisjordanie. La Palestine se retrouve durablement divisée entre un Hamas maître de Gaza et une Autorité palestinienne confinée à Ramallah[8].
Le retour de Netanyahou et la consolidation du Hamas à Gaza
En 2009, Netanyahou revient au pouvoir avec une ligne claire : empêcher la création d’un État palestinien et maintenir la division interne. Plusieurs analystes soulignent que la domination du Hamas à Gaza sert ses objectifs, car elle permet de présenter les Palestiniens comme incapables d’unité et donc inéligibles à la reconnaissance internationale[9].
En 2015, Bezalel Smotrich, allié politique de Netanyahou, déclare que « l’Autorité palestinienne est un fardeau et le Hamas un atout », explicitant une logique où la présence du Hamas, radical et non reconnu, bloque toute perspective d’État palestinien[10].
Le financement qatari et les valises de cash
À partir de 2012, le Qatar devient le principal bailleur de fonds de Gaza. L’argent, souvent en espèces, transite régulièrement par Israël avec l’accord du gouvernement. En novembre 2018, des valises contenant quinze millions de dollars passent par le point de passage d’Erez avec l’aval d’Israël. Ces images, relayées par la presse, illustrent cette situation inédite[11].
Officiellement, ces fonds servent à payer les salaires des fonctionnaires et à acheter du carburant, afin d’éviter une crise humanitaire. Mais de nombreux observateurs notent que ce mécanisme permet surtout au Hamas de rester au pouvoir. Netanyahou, en autorisant ces transferts, garantit un statu quo : le Hamas tient Gaza, l’Autorité palestinienne est marginalisée et la perspective d’un État palestinien s’éloigne[12].
L’opposition israélienne accuse Netanyahou d’avoir nourri le Hamas pour éviter toute négociation avec Mahmoud Abbas. Ses partisans expliquent qu’il s’agissait d’acheter une accalmie. Le résultat est néanmoins que Gaza est resté sous contrôle du Hamas, divisé de la Cisjordanie, tandis que Netanyahou consolidait son pouvoir intérieur en se présentant comme le seul garant de la sécurité face à un ennemi irréductible.
Perte de contrôle ?
De la reconnaissance de Mujama al‑Islamiya en 1979 aux valises de cash de 2018, en passant par les élections de 2006 et la prise de pouvoir du Hamas à Gaza en 2007, l’histoire montre une constante : Israël, et plus particulièrement Benjamin Netanyahou, ont favorisé la consolidation du Hamas pour des raisons purement stratégiques. Le Hamas a servi d’outil de division, affaiblissant l’OLP et bloquant la perspective d’un État palestinien unifié. Ce choix a permis au Hamas de financer sa militarisation et de s’enraciner à Gaza.
En soutenant le Hamas et en torpillant les accords d’Oslo, Netanyahou a indéniablement contribué à perpétuer une spirale de violences dont les deux peuples paient directement le prix. La responsabilité politique de ces victimes, qu’elles soient israéliennes ou palestiniennes, ne peut être dissociée de ce choix stratégique.
Reste une interrogation : le Hamas a-t-il cessé d’être un atout stratégique pour Netanyahou, ou cette instrumentalisation a-t-elle servi à légitimer l’intervention militaire à Gaza ?
Marcan pour BAM!
[1] Hamas | Definition, History, Ideology, & Facts | Britannica
[2] How Israel Helped To Spawn Hamas | PDF
[3] General Staff Report: Large Rise in Number of Rapes in IDF - Haaretz Com
[4] The Avalon Project : Hamas Covenant 1988
[5] Jaffa Road bus bombings - Wikipedia
[6] Retrait israélien de la bande de Gaza — Wikipédia
[7] Row erupts as top Sharon aide says there will be no Palestinian state | World news | The Guardian
[8] Hamas takes control of Gaza | Palestinian territories | The Guardian
[9] How Israel helped prop up Hamas for decades | Analyst News
[10] For years, Netanyahu propped up Hamas. Now it's blown up in our faces | The Times of Israel
[11] Three suitcases stuffed with $15 million passed to Hamas in Gaza | The Jerusalem Post
[12] Israel sent suitcases of cash into Gaza for years despite concerns about funding Hamas