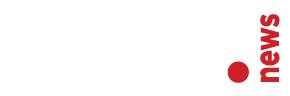En Allemagne, plus de 200 médecins et scientifiques ont signé une déclaration demandant la suspension temporaire des vaccins à ARNm contre le Covid‑19[1]. L’initiative met en lumière un ensemble de critiques sur la gestion scientifique et politique de la vaccination. Les signataires estiment que les lacunes dans l’évaluation et la surveillance imposent un retour au principe de précaution.
Faible suivi des effets indésirables
Le Paul‑Ehrlich‑Institut, autorité fédérale en charge des vaccins, a enregistré plusieurs centaines de milliers de signalements d’effets indésirables depuis le début de la campagne. Une proportion significative concerne des complications graves, notamment cardiaques. Les auteurs du moratoire jugent que ce volume de notifications, même sans démonstration systématique de causalité, mérite un examen indépendant et approfondi. Ils reprochent aux autorités un suivi insuffisant, qui ne permet pas de tirer des conclusions solides sur la fréquence et la gravité réelles de ces événements.
Questions sur les mécanismes biologiques
Les critiques portent aussi sur des zones d’ombre scientifiques. Selon les signataires, il n’existe pas de données publiées suffisamment précises sur la durée et la localisation de la production de protéine Spike après injection, ni sur la présence possible de polypeptides produits par décalage de lecture. L’incertitude concerne également à la fertilité, à la grossesse et aux effets à long terme, qui n’ont pas encore été étudiés de manière exhaustive. Ces lacunes sont présentées comme un argument en faveur d’un moratoire, le temps d’obtenir des réponses par des études indépendantes.
Erreurs méthodologiques
Autre sujet de contestation : la communication initiale sur une efficacité de 95 %. Les auteurs estiment que ce chiffre, largement repris dans les campagnes publiques, reposait sur des essais de courte durée, dans un contexte de faible circulation virale et sur des critères partiels. Depuis, l’efficacité réelle, notamment contre les formes graves et la mortalité, a surtout été mesurée à travers des analyses rétrospectives ou des modélisations. Celles‑ci, selon les signataires, comportent des biais méthodologiques significatifs.
Un reproche majeur concerne la manière dont l’efficacité vaccinale a été calculée. Les signataires soulignent que de nombreuses études excluent les 14 premiers jours suivant l’injection, période pendant laquelle les infections ou complications ne sont pas comptabilisées. Cette exclusion pose plusieurs problèmes : d’abord, les jours qui suivent immédiatement l’injection sont précisément ceux où les effets indésirables sont les plus fréquents et fortement corrélés. Ensuite, le calcul de l’efficacité globale devrait inclure cette période, car la réaction immunitaire au vaccin entraîne une désorganisation temporaire du système immunitaire, pouvant augmenter la vulnérabilité aux infections, y compris au Covid lui‑même. Enfin, la comparaison entre groupes vaccinés et non vaccinés est biaisée : une partie significative des pathologies et des infections sont retirées artificiellement du groupe vacciné et ajoutées au groupe témoin, donnant une image faussement favorable du vaccin.
Manque de transparence
Au‑delà des aspects médicaux, la déclaration met en cause la gouvernance scientifique. Les auteurs dénoncent un manque de transparence dans la conduite des essais cliniques, ainsi que l’absence d’évaluations régulières et indépendantes des données de pharmacovigilance. Ils estiment que ce déficit de contrôle alimente la méfiance du public et nuit à la crédibilité des institutions.
Principe de précaution
La demande de moratoire ne repose pas sur des preuves définitives de dangerosité, mais sur le constat que des incertitudes importantes subsistent plusieurs années après l’autorisation. Les signataires considèrent qu’il est nécessaire de suspendre temporairement l’utilisation des vaccins à ARNm tant que le rapport bénéfice‑risque n’aura pas été clarifié de manière indépendante, transparente et méthodologiquement solide.
Science en temps de crise
L’initiative allemande met aussi en évidence un problème plus général : la tension entre la science produite dans l’urgence d’une pandémie et les standards classiques de validation scientifique. Cette accélération a laissé ouvertes des questions fondamentales, qui nourrissent aujourd’hui des demandes de réévaluation. Le débat ne se limite donc pas à la sécurité des vaccins, mais interroge la manière dont les politiques de santé publique s’articulent avec les exigences de rigueur scientifique en période de crise.
BAM detox
[1] Hunderte Wissenschaftler fordern Stopp der mRNA‑Impfstoffe: Wie gravierend sind die Nebenwirkungen?